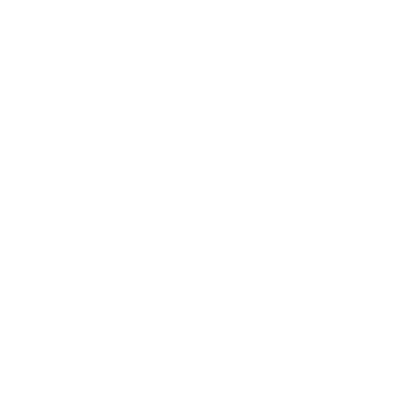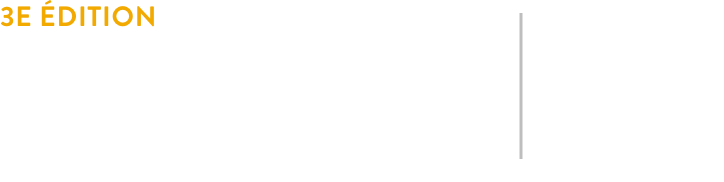Chapitre 13
Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est un élément central dans la vie d’une coopérative d’habitation. Il est en quelque sorte la courroie de transmission entre les membres, l’assemblée des membres, les comités, les organismes gouvernementaux, les fournisseurs et les partenaires de la coopérative.
Rappelons que les administrateurs sont élus par l’assemblée des membres, habituellement lors de l’assemblée annuelle (L.c., art. 76, par. 3) Voir la section''Rôles de l’assemblée'' (Section 12.2) .
Section 13.1
Composition du conseil d'administration
Le nombre d’administrateurs de la coopérative est déterminé par le Règlement de régie interne. Le conseil doit cependant compter au moins trois et au plus 15 administrateurs (L.c., art. 80).
Taille du conseil
Le nombre d’administrateurs peut avoir un impact sur l’efficacité du conseil d’administration. La taille du conseil devrait tenir compte, notamment, du nombre de logements que possède la coopérative. Ainsi, un conseil d’administration composé de cinq ou sept membres pourrait parfaitement convenir dans le cas d’une coopérative qui compte 20 ou 30 logements. Inversement, un conseil de plus petite taille, par exemple trois administrateurs, pourrait parfois s’avérer mieux adapté à la réalité d’une coopérative ne comptant que 10 logements.
Fiche juridique
13.1.1. - Qui peut être administrateur?
Les membres résidents : Tous les membres d’une coopérative d’habitation sont éligibles, en principe, pour siéger au conseil d’administration (L.c., art. 81). Il s’agira le plus souvent des personnes physiques qui résident dans la coopérative, soit à titre de locataires dans le cas des coopératives d’habitation locatives – catégorie consommateurs, soit à titre de propriétaires des logements dans le cas des coopératives de propriétaires.
Les membres travailleurs et les membres de soutien : Dans les coopératives de solidarité en habitation, en plus des membres résidents, les membres de soutien ainsi que leurs représentants lorsqu’il s’agit de personnes morales peuvent aussi siéger au conseil (L.c., art. 226.6). Lorsqu’une coopérative de solidarité en habitation compte des travailleurs parmi ses membres, ceux-ci sont également éligibles pour siéger au conseil d’administration.
Des personnes non membres
Le Règlement de régie interne peut par ailleurs prévoir la présence au conseil de personnes qui ne sont pas membres de la coopérative (L.c., art. 81.1). Ces administrateurs non membres, tout comme les membres de soutien ou leur représentant dans les coopératives de solidarité en habitation, sont susceptibles d’apporter au conseil d’administration, notamment :
- Des compétences complémentaires à celles des membres (ex. : expertise dans les domaines immobilier, coopératif, financier, communautaire, etc.);
- Des contacts et des ressources pouvant s’avérer utiles à la coopérative;
- Une perspective extérieure sur certains enjeux;
- La capacité d’apporter un point de vue plus indépendant, étant donné qu’ils n’ont pas à porter plusieurs chapeaux (ex. : membre et administrateur).
Lorsqu’ils siègent au conseil, les administrateurs non membres ont les mêmes pouvoirs et devoirs que les administrateurs membres. Ils doivent être convoqués aux réunions du conseil, ont le droit de prendre la parole, de proposer et d’appuyer des résolutions et de voter. Ils ont également le droit d’être convoqués aux assemblées générales et d’y assister avec droit de parole. Ils n’ont toutefois aucun droit de vote lors des assemblées.
Les administrateurs non membres sont élus par l’assemblée des membres après que leur candidature eut été recommandée par le conseil d’administration.
Mentionnons que le nombre de postes au conseil occupés par des membres de soutien ou des personnes non membres ne peut excéder le tiers du nombre total de postes d’administrateurs de la coopérative (L.c., art. 81.1.1). Ainsi, les membres-résidents conservent toujours le contrôle sur l’ensemble des décisions de la coopérative.
13.1.2. - Inhabileté à être un administrateur d'une coopérative
Selon l’article 327 du Code civil du Québec, les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction sont inhabiles à être administrateurs d’une personne morale.
Fiche juridiquePossibilité pour un mineur d’agir comme administrateur
Une personne âgée de moins de 18 ans peut néanmoins agir comme administrateur d’une coopérative dont l’objet la concerne (L.c., art. 81.2). Concrètement, le fait d’être membre de la coopérative suffit pour qu’une personne mineure soit éligible à un poste d’administrateur.
Les personnes majeures en tutelle ou en curatelle
Malgré le principe de l’inhabileté des majeurs en tutelle ou en curatelle à être administrateur, l’article 327 du Code civil prévoit que les majeurs en tutelle peuvent être administrateurs d’une association constituée en personne morale qui n’a pas pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires et dont l’objet les concerne. Le majeur sous tutelle aurait donc, vraisemblablement, le droit d’être administrateur d’une coopérative d’habitation, du moins dans le cas d’une coopérative d’habitation locative.
Tutelle et curatelle
La tutelle et la curatelle sont deux régimes de protection destinés aux personnes qui sont inaptes à prendre soin d’elles-mêmes et de leurs biens. On parle d’un régime de tutelle lorsque l’inaptitude n’est que partielle ou temporaire. On procède à l’ouverture d’un régime de curatelle lorsque l’inaptitude d’une personne à prendre soin d’elle-même ou de ses biens est totale et permanente.
Pour en apprendre davantage sur les régimes de tutelles et de curatelle, consulter le site Internet du Curateur public du Québec à : www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/index.html.
Les faillis
Les faillis ne peuvent agir comme administrateur d’une personne morale, incluant une coopérative. Un failli est une personne qui a déclaré faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Le failli conserve ce statut tant qu’il n’a pas obtenu sa libération. Donc, une fois libérée de sa faillite par le tribunal, cette personne peut légalement être administrateur d’une coopérative d’habitation.
Les personnes interdites d’exercice de la fonction d’administrateur
En vertu de l’article 329 du Code civil du Québec, le tribunal peut interdire l’exercice de la fonction d’administrateur d’une personne morale à toute personne trouvée coupable d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes morales, ainsi qu’à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d’administrateur. Une personne contre qui une telle interdiction a été prononcée ne peut évidemment pas être administrateur d’une coopérative d’habitation.
13.1.3. - Les causes d'inéligibilité
Votre coopérative devrait inclure dans son Règlement de régie interne une disposition prévoyant qu’un membre est inéligible au poste d’administrateur dans l’un ou l’autre des cas suivants (L.c., art. 82) :
- S’il n’a pas acquitté les versements échus sur ses parts ou tout autre montant exigible (ex. : loyer impayé);
- Si, pendant l’exercice financier précédent, il n’a pas fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
- Si, dans le cas d’une coopérative de solidarité en habitation comptant des membres travailleurs, l’un de ceux-ci n’a pas, pendant l’exercice financier précédent, fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement ou effectué le nombre de jours de travail déterminé par règlement.
La coopérative ne peut en aucun cas déterminer d’autres causes d’inéligibilité des membres à siéger au conseil d’administration.
Section 13.2
Mandat des administrateurs
Dans cette section, nous abordons principalement la durée et la terminaison du mandat des administrateurs, ainsi que les modalités de remplacement de ces derniers.
13.2.1. - Durée du mandat
Le Règlement de régie interne détermine la durée du mandat des administrateurs, qui ne peut toutefois excéder trois ans. Si la coopérative n’a pas prévu la durée du mandat dans son règlement, la Loi sur les coopératives prévoit par défaut une durée d’un an (L.c., art. 84).
Fiche juridiqueL’administrateur est cependant rééligible, c’est-à-dire qu’il peut être élu pour plusieurs mandats, consécutifs ou non. Une disposition du Règlement de régie interne limitant le nombre de mandats ou de mandats consécutifs d’un administrateur serait contraire à la Loi. En effet, une telle disposition aurait pour effet, indirectement, de créer une nouvelle cause d’inéligibilité à un poste d’administrateur. Or, les seules causes d’inéligibilité qu’une coopérative peut prévoir dans son règlement sont celles énumérées à l’article 82 de la Loi.
Il est de pratique courante d’avoir des termes de deux ans et de prévoir un mécanisme de rotation qui assurera une continuité au sein du conseil. Par exemple, on peut ainsi prévoir que certains administrateurs seront élus les années paires et que les autres le seront les années impaires. Si vous voulez mettre en place ce système de rotation, prévoyez la première année des mandats d’un an pour une partie des administrateurs.
L’article 84 de la Loi prévoit de plus qu’à la fin de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé. Cette règle permet d’éviter qu’une coopérative se retrouve devant un vide administratif dans l’hypothèse où plus d’une année se serait écoulée entre deux assemblées annuelles. Supposons, en effet, que les cinq administrateurs de cette coopérative aient été élus le 1er avril 2021 pour un mandat d’une année et que, pour diverses raisons, l’assemblée annuelle suivante n’ait lieu que le 15 mai 2022. Le maintien en fonction des administrateurs prévu à l’article 84 de la Loi éviterait, dans l’hypothèse précédente, que la coopérative se retrouve sans conseil d’administration pendant un mois et demi ou encore qu’elle soit obligée de tenir une assemblée extraordinaire.
13.2.2. - Démission d'un administrateur
Un administrateur peut résigner ses fonctions, c’est-à-dire démissionner de son poste d’administrateur, en donnant un avis écrit au conseil d’administration (L.c., art. 86). Le président doit lire l’avis de démission au conseil d’administration. Le conseil prend alors acte de la démission et le secrétaire de la réunion note celle-ci au procès-verbal.
Rappelons, par ailleurs, que la démission d’une personne à titre de membre de la coopérative entraîne automatiquement sa déchéance à titre d’administrateurVoir la sous-section ''Déchéance comme administrateur (en cas de démission'' (Sous-section 10.3.2) .
13.2.3. - Poste vacant au conseil
Lorsqu’un poste au conseil devient vacant en cours de mandat, le conseil d’administration a le pouvoir de coopter un administrateur pour pourvoir à cette vacance (L.c., art. 85). Coopter signifie que les administrateurs restants peuvent nommer une personne éligible au poste d’administrateur pour la durée non écoulée du mandat.
Lorsque le conseil décide de pourvoir lui-même à un poste vacant, il devrait d’abord identifier une personne capable d’occuper la charge d’administrateur et susceptible d’amener un apport positif à la coopérative. Il devrait ensuite sonder l’intérêt et la disponibilité de cette personne pour siéger au conseil. Attention! Un appel à tous, par exemple au moyen d’une communication écrite ou d’un affichage sur le babillard, pourrait réserver de mauvaises surprises. Le conseil pourrait, en effet, se retrouver alors face à un choix difficile : accepter une personne qui n’aurait pas les qualités requises ou risquer des tensions après avoir décliné l’offre de cette personne.
Le poste vacant peut également être pourvu lors d’une assemblée générale.
Si le nombre des administrateurs qui demeurent en fonction n’est pas suffisant pour former quorum, les personnes suivantes peuvent décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire pour pourvoir aux vacances, c’est-à-dire qu’elles peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une telle assemblée :
- Un administrateur;
- Deux membres de la coopérative;
- S’il y lieu, le conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre.
Si le secrétaire omet de convoquer l’assemblée, ceux qui peuvent décréter la tenue de l’assemblée peuvent la convoquer eux-mêmes. La coopérative rembourse alors à ceux qui ont convoqué l’assemblée les frais utiles qu’ils ont engagés pour tenir l’assemblée.
13.2.4. - Révocation d'un administrateur
Puisque les administrateurs sont élus par les membres, il est logique que seuls ces derniers aient le pouvoir de révoquer leur mandat avant terme (L.c., art. 99). Le pouvoir de révocation de l’assemblée s’applique à tous les administrateurs de la coopérative, qu’il s’agisse :
- D’un administrateur qui est membre de la coopérative et qui a été élu par l’assemblée;
- D’un administrateur nommé (ou coopté) par le conseil à la suite d’une vacance;
- D’un administrateur non membre.
Motifs de la révocation
La Loi sur les coopératives n’énumère pas directement les motifs qui peuvent justifier la révocation d’un administrateur. Puisque la Loi exige la révocation préalable du mandat à titre d’administrateur d’un membre que la coopérative envisage d’exclure, on peut en déduire que tous les motifs justifiant l’exclusion d’un membre peuvent être invoqués pour sa révocation à titre d’administrateur Voir la sous-section ''Motifs pouvant justifier la suspension et l’exclusion d’un membre'' (Sous-section 10.2.2) .
La Loi ne limite toutefois pas les motifs de révocation aux seules raisons qui justifieraient une exclusion. Le législateur a ainsi laissé une certaine latitude aux membres, car le mandat donné par ces derniers aux administrateurs repose en grande partie sur la confiance.
La révocation doit cependant énoncer des motifs assez précis, dont voici quelques exemples que l’on rencontre en pratique :
- Nombreuses absences injustifiées aux réunions du conseil;
- Manquement aux règles d’éthique imposées aux administrateurs, notamment les conflits d’intérêts non déclarés et grâce auxquels l’administrateur concerné a tiré avantage pour lui ou ses proches;
- Non-respect de la Loi, des règlements ou des politiques de la coopérative;
- Manquement à la confidentialité des délibérations du conseil;
- Détournement ou destruction volontaire des biens appartenant à la coopérative;
- Défaut de paiement des parts sociales ou des loyers à la coopérative;
- Rétention volontaire d’informations essentielles à la coopérative.
Procédure de révocation
La révocation a lieu lors d’une assemblée extraordinaire. L’administrateur ne peut être révoqué que s’il a été informé par écrit, dans le délai prévu pour la convocation de l’assemblée, des motifs invoqués pour sa révocation ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée (L.c., art. 101).
L’administrateur peut, lors de cette assemblée, s’opposer à sa révocation en y faisant des représentations ou en transmettant une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée.
Vacance à la suite de la révocation
Une vacance au conseil d’administration provoquée par la révocation d’un administrateur peut être pourvue par l’élection d’un nouvel administrateur lors de l’assemblée extraordinaire où a eu lieu la révocation (L.c., art. 100). L’avis de convocation de cette assemblée doit absolument mentionner la tenue d’une telle élection si la résolution de révocation est adoptée.
Si le poste vacant n’est pas pourvu lors de cette assemblée extraordinaire, le conseil pourra lui-même pourvoir le poste par cooptation conformément à l’article 85 de la Loi.
Section 13.3
Pouvoirs, devoirs et responsabilité des administrateurs
Le conseil d’administration dispose d’importants pouvoirs au sein d’une coopérative d’habitation. La Loi impose toutefois aux administrateurs des devoirs conséquents et les rend imputables devant les membres des décisions qu’ils prennent.
13.3.1. - Pouvoirs des administrateurs
Un pouvoir qui s’exerce collégialement
Le conseil d’administration n’exerce ses pouvoirs que lorsque les administrateurs sont réunis à l’occasion d’une réunion dûment convoquée et régulièrement tenue. Ce n’est que dans cette circonstance que les administrateurs peuvent collectivement prendre des décisions et agir.
Fiche juridiqueIndividuellement, les administrateurs – incluant le président – n’ont aucun pouvoir, sauf ceux qui leur sont conférés en vertu de la Loi et des règlements de la coopérative ou à la suite d’une résolution du conseil d’administration. Autrement, ils ne peuvent à titre individuel ni engager ni représenter la coopérative.
Pouvoirs généraux
L’article 89 de la Loi donne au conseil d’administration un pouvoir général d’administration des affaires de la coopérative. Ce pouvoir général inclut, notamment :
- La gestion des immeubles appartenant à la coopérative;
- La gestion de ses finances;
- La conclusion et la gestion des baux;
- L’adoption de politiques;
- En général, la réalisation de l’ensemble des activités de la coopérative.
Pouvoirs spécifiques
En plus du pouvoir général d’administrer la coopérative, la Loi confère au conseil certains pouvoirs spécifiques et dont l’exercice lui est réservé exclusivement, notamment :
- Admettre les nouveaux membres (c., art. 51);
- Accepter la démission d’un membre avant l’expiration du délai prévu par la Loi (c., art. 55);
- Imposer des mesures disciplinaires (suspension et exclusion des membres) (c., art. 57);
- Choisir les dirigeants (L.c., 113 et art. 116);
- Rembourser (c., art. 38.1) ou confisquer les parts de qualification (L.c., art. 43);
- Approuver le transfert des parts sociales (c., art. 39);
- Déterminer les caractéristiques des parts privilégiées (c., art. 46);
- Adopter une résolution pour adhérer à la fédération et la faire ratifier par l’assemblée (c., art. 229);
- Approuver une convention de fusion à titre de coopérative absorbante (c., art. 168).
Restrictions aux pouvoirs du conseil
En vertu de la Loi sur les coopératives
L’article 89 de la Loi sur les coopératives prévoit certaines limitations aux pouvoirs du conseil. Ainsi, l’assemblée des membres peut, par règlement, soumettre à son autorisation l’exercice de certains pouvoirs du conseil d’administration, sauf dans le cas des pouvoirs réservés exclusivement au conseil par la Loi (ex. : admission des nouveaux membres, imposition de mesures disciplinaires, etc.).
De même, le conseil d’administration ne peut emprunter ni hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens de la coopérative sans y être autorisé par un règlement adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée. Ce règlement est appelé Règlement d’emprunt et d’attribution de garantie Voir la sous-section ''Principaux règlements'' (Sous-section 4.2.3) .
Toujours en vertu de l’article 89, le conseil d’administration ne peut vendre, louer ou échanger la totalité ou la quasi-totalité Selon une interprétation généralement retenue, la « quasi-totalité » des biens référerait à environ 90 % et plus des actifs de l’entreprise. des biens de la coopérative (ex. : les immeubles à logements dans le cas d’une coopérative d’habitation), hors du cours normal de ses affaires, sans y être autorisé par un règlement adopté aux trois quarts des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée générale.
Vente des immeubles sujette à approbation du ministre
En vertu de l’article 221.2.5 de la Loi, une coopérative ne peut vendre ou autrement aliéner un immeuble ayant été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre .
Mentionnons également que la décision du conseil d’administration d’une coopérative de démissionner de la fédération dont elle est membre doit être ratifiée par l’assemblée générale de la coopérative (L.c., art. 232.1).
En vertu des conventions d’exploitation
Les conventions d’exploitation conclues par la majorité des coopératives d’habitation comportent des limitations aux pouvoirs du conseil d’administration. Ces limitations diffèrent d’un programme à l’autre, mais la plupart d’entre eux contiennent des restrictions en ce qui a trait à l’affectation des immeubles de la coopérative – c’est-à-dire les fins pour lesquelles ils sont utilisés–, à leur vente, à la conclusion d’ententes de gestion, à l’approbation du budget et des états financiers, à l’utilisation de la réserve de remplacement, à l’attribution des logements à loyer modique, à l’adhésion à une fédération, à la modification des logements (nombre et typologie), etc.
En vertu de la Loi sur la Société d’habitation
La Loi sur la Société d’habitation prévoit que la Société d’habitation (SHQ) peut, dans certaines circonstances, imposer un régime d’administration provisoire aux coopératives d’habitation qui reçoivent une aide financière de la SHQ (L.S.H.Q., art 85.2). Dans le cadre de ce régime, les pouvoirs du conseil d’administration de la coopérative sont suspendus pour une période d’au plus 120 jours (pouvant être prolongée pour des périodes additionnelles maximales de 90 jours – L.S.H.Q., art. 85.2) et la SHQ nomme un ou des administrateurs provisoires pour exercer leurs pouvoirs durant cette suspension.
L’imposition du régime d’administration provisoire peut survenir dans les cas suivants :
- Les administrateurs ont manqué aux obligations que le Code civil impose aux administrateurs d’une personne morale ou à celles que leur impose la Loi sur la Société d’habitation ou un règlement pris pour son application ou qui découle d’un programme d’habitation ou d’un accord aux termes duquel l’organisme reçoit de l’aide financière;
- Il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de la coopérative;
- Un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de la coopérative ont posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit de l’aide financière accordée sur les fonds publics;
- Des pratiques incompatibles avec les objectifs ou les normes du programme d’habitation en vertu duquel l’aide financière est octroyée à la coopérative ont eu cours au sein de celui-ci;
- Un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de la coopérative ont intimidé, harcelé ou maltraité tout occupant d’un logement situé dans un immeuble d’habitation appartenant la coopérative ou n’ont posé aucun acte pour mettre fin à la maltraitance, au harcèlement ou à l’intimidation qui leur est dénoncé.
13.3.2. - Devoirs des administrateurs
Devoirs généraux prévus au Code civil
Le Code civil du Québec édicte certains devoirs qui s’imposent aux administrateurs de toutes personnes morales, dont les coopératives.
Fiche juridiqueTant collectivement qu’individuellement, les administrateurs de la coopérative sont considérés comme des mandataires de cette dernière (L.c., art. 91). À ce titre, ils doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, respecter les obligations que la Loi, l’acte constitutif et les règlements leur imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés (C.c.Q., art. 321).
Les administrateurs doivent agir avec prudence et diligence. Le devoir de prudence et de diligence impose, entre autres, aux administrateurs :
- De se préparer adéquatement pour les réunions, par exemple en lisant attentivement la documentation transmise au préalable et en notant les interrogations qu’ils ont en lien avec les différents sujets à l’ordre du jour;
- D’assister aux réunions et d’être attentifs afin de demeurer pleinement informés de tous les aspects liés à l’exploitation de la coopérative;
- De demander des éclaircissements dans le cas où ils ne comprennent pas bien un sujet discuté;
- De demander de reporter une décision lorsque l’information fournie et les discussions ne permettent pas de se faire clairement une idée sur le sujet;
- De comprendre et de respecter les limites de leurs compétences, en ayant recours au besoin à des ressources externes détenant l’expertise nécessaire;
- Si la coopérative a des employés, d’exiger à chaque réunion la preuve du paiement aux autorités gouvernementales des différentes retenues à la source (impôt sur le revenu, assurance chômage, Régime des rentes, cotisation CNESST, etc.).
Présence aux réunions
L’article 97 de la Loi prévoit qu’un administrateur présent à une réunion du conseil est réputé avoir acquiescé à toute résolution adoptée ou toute mesure prise alors qu’il est présent à cette réunion, sauf dans les cas suivants :
- S’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
- S’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
L’article 98 indique, pour sa part, qu’un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé n’avoir approuvé aucune résolution ni participé à aucune mesure prise en son absence.
Les administrateurs doivent également agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la coopérative (C.c.Q., art. 322). Cela implique, entre autres :
- D’agir de bonne foi avec pour seul objectif le bien de la coopérative, sans tenir compte des intérêts particuliers d’autres personnes, groupes ou organisations (ex. : un administrateur ne doit pas défendre les intérêts particuliers des personnes qui l’ont élu);
- De ne pas commettre d’abus de pouvoir dans le but de procurer des avantages à eux-mêmes (ou à d’autres);
- De demeurer indépendants de toute pression ou influence. Cela signifie notamment qu’ils ne doivent pas se lier d’avance dans la manière dont ils prendront leurs décisions et qu’ils doivent éviter de donner préséance à des intérêts autres que ceux de la coopérative et de l’ensemble de ses membres (ex. : un administrateur ne peut s’engager envers un membre ou un tiers à voter dans un sens ou dans un autre sur un sujet donné, en échange d’avantages ou d’autres considérations).
Autres règles de conduite
Les administrateurs d’une coopérative doivent agir en fonction des valeurs de la coopérative et avoir un comportement exemplaire. Ils doivent, notamment :
- Agir en conformité avec les valeurs et principes coopératifs;
- Agir dans l’exercice de leurs fonctions avec bonne foi, honnêteté, loyauté, assiduité et équité;
- Entretenir à l’égard des administrateurs, des dirigeants et des membres de la coopérative des relations fondées sur le respect, l’équité et la coopération;
- Éviter les situations mettant en conflit leurs intérêts et ceux de la coopérative. En cas de conflit d’intérêts ou d’apparence d’un tel conflit, il convient de le dénoncer au conseil et de s’abstenir de participer aux discussions et à la prise de décision ou d’influencer le vote des autres administrateurs (c., art. 106);
- Respecter la vie privée et la confidentialité des informations qui sont portées à leur connaissance dans l’exercice de leur fonction;
- Avoir une attitude et des gestes exempts de toute forme de discrimination;
- S’abstenir de toute forme de harcèlement, d’intimidation, d’abus ou de maltraitance à l’égard des membres, administrateurs, employés, fournisseurs et autres collaborateurs ou partenaires de la coopérative et dénoncer de tels comportements.
La coopérative devrait adopter un Code d’éthique et de déontologie qui s’applique aux administrateurs, aux dirigeants, ainsi qu’aux membres de comités.
Devoirs spécifiques prévus dans la Loi sur les coopératives
L’article 90 de la Loi sur les coopératives impose au conseil une série de devoirs plus spécifiques :
- Engager un directeur général ou gérant, à moins d’une disposition d’un règlement à l’effet contraire;
- Assurer la coopérative contre les risques qu’il détermine, sous réserve des exigences et restrictions prévues par règlement;
- Désigner les personnes autorisées à signer au nom de la coopérative tout contrat ou autre document;
- Lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel;
- Faire une recommandation à l’assemblée annuelle concernant l’affectation des trop-perçus ou excédents;
- S’il y a lieu, faire une recommandation à l’assemblée concernant l’élection des administrateurs non membres;
- Faciliter le travail du vérificateur (auditeur indépendant);
- Encourager la formation en matière de coopération des membres, des administrateurs, des dirigeants et des employés de la coopérative, puis favoriser l’information du public sur la nature et les avantages de la coopération;
- Promouvoir la coopération entre les membres, entre les membres et la coopérative et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
- Favoriser le soutien au développement du milieu où la coopérative exerce ses activités;
- Fournir au ministre, si ce dernier en fait la demande, une copie des règlements ainsi que les renseignements et documents qu’il pourrait requérir.
On retrouve, ailleurs dans la Loi, d’autres devoirs imposés aux administrateurs. Par exemple, le conseil doit, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier, préparer le rapport annuel (L.c., art. 132). Le conseil doit également transmettre une copie du rapport annuel au ministre et à la fédération dont la coopérative est membre dans les 30 jours qui suivent l’assemblée annuelle (L.c., art. 134).
13.3.3. - Responsabilités légale des administrateurs
En vertu du Code civil du Québec
Comme c’est le cas pour toutes personnes physiques ou morales, les administrateurs d’une coopérative d’habitation sont susceptibles, en principe, de faire l’objet d’une réclamation pour les dommages causés à autrui par leur faute, notamment dans le cas de manquements aux devoirs de prudence, de diligence, d’honnêteté et de loyauté (C.c.Q., art. 1457). Un tel recours en responsabilité civile pourrait être entrepris par :
- La coopérative;
- D’autres administrateurs;
- Des membres;
- Des tiers.
Toutefois, dans le cas d’administrateurs bénévoles d’organismes sans but lucratif ou de coopératives, les poursuites s’avèrent rares dans les faits et les condamnations encore plus rares, sauf en cas de fraude, de négligence grossière ou de faute grave.
En vertu d’autres lois
En plus des recours en dommages-intérêts en lien avec les devoirs généraux des administrateurs (prudence, diligence, loyauté, etc.), les administrateurs d’une coopérative d’habitation sont susceptibles d’être poursuivis en vertu de nombreuses lois, tant provinciales que fédérales. Parmi celles-ci, nous retrouvons les obligations qui découlent des lois en matière fiscale, en matière de faillite et d’insolvabilité, mais aussi celles relatives à l’environnement, à la santé et sécurité au travail, etc.
Certaines de ces lois comportent également des dispositions de nature pénale, en vertu desquelles un ou des administrateurs d’une coopérative pourraient être poursuivis et éventuellement être condamnés à payer des pénalités ou des amendes. Par exemple, en vertu de la Loi sur les coopératives, les administrateurs d’une coopérative d’habitation qui procéderaient à un partage illicite des biens de la coopérative ou décideraient de vendre un immeuble ayant été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation sans l’autorisation du ministre pourraient se voir imposer des amendes pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars (L.c., art. 147, art. 221.2.5, art. 246.1 et art. 248.1 Voir également à ce sujet la sous-section '' En vertu de la Loi sur les coopératives'' (Sous-section 16.3.3) .
13.3.4. - Se prémunir et se défendre contre les poursuites
Agir avec prudence et diligence
La meilleure façon pour les administrateurs d’éviter les problèmes et d’éventuelles réclamations consiste à être vigilants et prudents. Soyez conscients de vos responsabilités et assurez-vous d’accomplir votre mandat en vous conformant aux devoirs et obligations qui vous incombent.
COMMENT DIMINUER LES RISQUES DE RESPONSABILITÉ?
Voici quelques mesures de prudence qui permettent d’atténuer les risques de responsabilité des administrateurs. Ainsi, pour limiter les risques, l’administrateur devrait :
- Connaître et respecter :
- La Loi sur les coopératives et les autres lois qui constituent l’environnement juridique immédiat de la coopérative et qui s’appliquent à elle compte tenu de sa nature et des activités qu’elle exerce;
- Les statuts, règlements et politiques internes de la coopérative;
- Les limites des pouvoirs qui lui sont conférés et agir à l’intérieur de celles-ci.
- Assister à toutes les réunions du conseil d’administration.
- Structurer et documenter les processus décisionnels :
- Avoir en main toute l’information requise disponible avant de prendre une décision;
- Lire les documents remis;
- Intervenir dans les délibérations, demander des explications, donner son opinion et voter en toute liberté;
- Demander l’avis de professionnels ou d’experts lorsque la situation dépasse ses connaissances et ses compétences;
- Reporter les décisions sur des matières sur lesquelles il semble manquer d’information ou si une réflexion reste à faire;
- Valider toute l’information contenue dans les procès-verbaux avant de les adopter.
- Se doter d’un code d’éthique et de déontologie.
- Éviter les situations de conflits d’intérêts en les dénonçant lorsqu’elles surviennent et en se retirant de l’ensemble du processus décisionnel.
- Gérer la protection des renseignements personnels que la coopérative recueille, détient, utilise ou communique dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
- Assurer la coopérative d’habitation pour toutes les couvertures d’assurance adéquates couvrant les risques usuels et ceux liés à la nature de ses activités :
- assurance responsabilité civile;
- assurance responsabilité des administrateurs;
- assurance accident;
- assurance de biens (feu, vol, vandalisme).
- Avoir la rigueur de parfaire ses connaissances et ses habiletés d’administrateur en suivant de la formation.
Enregistrer sa dissidence
Si une résolution proposée vous paraît comporter trop de risque ou si une décision ne respecte pas, selon vous, la Loi ou les règles de l’art, alors n’hésitez pas à faire valoir votre point de vue, même si tous les autres administrateurs sont d’accord avec la résolution proposée. S’il y a lieu, vous devrez éventuellement, au moment du vote, enregistrer votre dissidence et demander que celle-ci soit portée au procès-verbal de la réunion. Évidemment, n’oubliez pas de lire le procès-verbal avant la prochaine réunion afin de vérifier que le secrétaire de la réunion a bien acquiescé à vos demandes!
Obligation de la coopérative de défendre ses administrateurs
En vertu de l’article 103 de la Loi, une coopérative doit assumer la défense de ses administrateurs (incluant les honoraires d’avocat) qui sont poursuivis par un tiers pour l’accomplissement d’un acte ou pour son omission dans l’exercice de leurs fonctions ou dans l’exécution d’un mandat au nom de la coopérative. La coopérative paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte ou de cette omission, sauf si l’administrateur ou le mandataire a commis une faute lourde ou une faute intentionnelle.
fiche juridiqueLorsqu’un administrateur fait l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle, la coopérative n’assumera le paiement des dépenses de ses administrateurs que dans les cas suivants :
- L’administrateur était justifié de croire que sa conduite était conforme à la Loi;
- L’administrateur a été libéré ou acquitté des accusations ou encore la poursuite a été retirée ou rejetée.
Une coopérative peut même être obligée d’assumer, en tout ou en partie, les dépenses de ses administrateurs qu’elle a elle-même poursuivis si, ultimement, elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi. Si la coopérative n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume (L.c., art. 104).
Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants
Afin d’assurer la tranquillité d’esprit des administrateurs et de protéger les intérêts de la coopérative, celle-ci doit souscrire une assurance Responsabilité des administrateurs et dirigeants. Ainsi, en cas de poursuite, c’est l’assureur qui prendra en charge le dossier Voir la sous-section''Assurances responsabilité de la coopérative'' (Sous-section 21.2.5) . N’oubliez pas que même si, en fin de compte, la poursuite ne conduit pas à une condamnation, les frais d’avocat représentent souvent à eux seuls une dépense considérable.
Dès votre arrivée en tant que nouvel administrateur, vous devriez demander si la coopérative a souscrit une telle assurance. La coopérative devrait fournir annuellement à ses administrateurs une preuve de renouvellement et de paiement de cette assurance.
Section 13.4
Rémunération et remboursement de frais
Les administrateurs de la coopérative n’ont droit à aucune rémunération (L.c., art. 102).
Ils ont toutefois droit au remboursement des dépenses engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Par exemple, l’administrateur qui, à la demande du conseil, participe à une activité organisée par la fédération pourra demander le remboursement des frais rattachés à l’utilisation de son véhicule. De même, les administrateurs qui doivent engager des dépenses pour faire garder leurs enfants lors d’activités de la coopérative pourraient réclamer ces dépenses.
Les règles relatives au remboursement des frais devraient être prévues dans une politique adoptée par le conseilVoir la documentation pour un modèle de politique de gestion financière.
La Loi permet également de verser aux administrateurs une allocation de présence, communément appelée « jetons de présence ». S’il y a lieu, celle-ci est déterminée par les membres lors de l’assemblée annuelle (L.c., art. 102). Dans les faits, toutefois, on ne retrouve pas de tels jetons de présence dans les coopératives d’habitation et cette pratique n’est pas recommandée.
Section 13.5
Organisation efficace du travail
Afin d’assurer la bonne gestion de la coopérative, le conseil d’administration doit organiser son fonctionnement de manière à optimiser l’efficacité de son travail et, par le fait même, celle des comités et d’autres collaborateurs.
13.5.1. - Planifier
Afin d’être efficace, le conseil d’administration devrait s’appuyer sur une planification de son travail. Nous avons vu au chapitre 11 l’importance pour la coopérative de faire une réflexion stratégique débouchant sur des orientations et un plan d’action. Le plan d’action constitue un excellent point de départ afin de permettre au conseil de structurer les actions à entreprendre et de s’assurer que celles-ci seront conformes aux orientations définies par les membres.
Le conseil d’administration devrait de plus concevoir un calendrier annuel de gestionregroupant l’ensemble des activités de gestion importantes au cours de l’année. Ce calendrier permet une meilleure supervision des tâches à effectuer et donne à tous les administrateurs une vue d’ensemble de leurs responsabilités. Les activités inscrites ne sont pas nécessairement exécutées par le conseil d’administration. Leur réalisation peut être confiée à des comités ou, s’il y a lieu, à la direction générale. Le conseil d’administration devrait consulter son calendrier à chacune de ses réunions pour ne pas perdre de vue les activités ou tâches à venir.
13.5.2. - Déléguer, superviser et coordonner
Apprendre à déléguer
Idéalement, le conseil d’administration devrait consacrer le plus de temps possible à planifier, à prendre des décisions, à assumer un leadership au sein de la coopérative, plutôt qu’à réaliser des tâches. Évidemment, dans une coopérative d’habitation de très petite taille (ex. : 12 logements ou moins), il est probable qu’une portion importante des tâches soient effectuées par les membres du conseil.
Le conseil d’administration devrait agir le plus possible comme chef d’orchestre. C’est pourquoi le conseil devrait mandater des instances ou différents intervenants pour réaliser le travail. Selon le mode de gestion adopté par la coopérative et la nature des mandats, il s’agira :
- De comités;
- D’un administrateur ou d’un membre;
- De la direction générale;
- De ressources externes (ex. : la fédération, un gestionnaire immobilier, un comptable, etc.).
L’art de superviser
Superviser est un art que le conseil doit apprendre à maîtriser, au risque sinon de paralyser les activités de gestion de la coopérative et de créer un climat tendu au sein de l’organisation. Afin d’obtenir une supervision efficace, il faut trouver le bon équilibre entre, d’une part, la confiance qu’il faut accorder aux collaborateurs (ex. : comités, directeur général, gestionnaire, etc.) et, d’autre part, la vigilance nécessaire pour s’assurer que les objectifs seront atteints. Ainsi, lorsque le conseil confie une responsabilité ou une tâche, il doit éviter de se substituer aux instances ou aux personnes qu’il a mandatées. Il doit plutôt prendre les mesures nécessaires pour que le travail soit fait, bien fait et dans les temps prévus. Pour atteindre cet objectif, le conseil doit :
- S’assurer que les personnes mandatées ont les compétences nécessaires;
- Donner des instructions claires;
- Exiger des rapports réguliers afin de vérifier l’avancement du travail;
- Vérifier que les tâches ont été réalisées convenablement.
Coordonner ou gérer le travail d’équipe
Souvent, la réalisation d’une tâche, d’une activité ou d’un projet nécessite la collaboration de plusieurs intervenants. Le conseil est parfois amené à jouer un rôle de coordonnateur, c’est-à-dire qu’il devra :
- Définir et communiquer l’objectif commun à tous les intervenants;
- Faire en sorte que les intervenants concernés connaissent et comprennent le travail qu’ils ont à accomplir, tout en ayant un bon aperçu de ce que les autres font;
- S’assurer que les intervenants communiquent entre eux et travaillent en équipe;
- Établir un climat de travail serein et motivant;
- Prévenir et gérer les conflits potentiels.
13.5.3. - Évaluer
L’évaluation est une composante essentielle d’une saine gouvernance d’entreprise. Elle permet de jeter un regard sur la façon dont les décisions ont été prises et sur la manière d’exercer la gestion des activités de la coopérative, et ce, dans une perspective d’amélioration continue. L’évaluation de la performance constitue le moyen privilégié pour accroître l’efficacité du conseil, de ses comités et de l’ensemble des collaborateurs.
QuestionnaireIl est sain de se questionner de temps à autre sur notre façon de fonctionner. Cela permet la réflexion et l’échange entre les administrateurs. Très souvent, une évaluation du fonctionnement du groupe permet d’apporter des changements bénéfiques. L’évaluation dont il est question ici est celle du fonctionnement du conseil d’administration et non du fonctionnement de la coopérative en général.
Bien que la formule d’une évaluation individuelle des administrateurs par les pairs soit utilisée dans certaines entreprises, une telle pratique comporte des risques, notamment en ce qui a trait au climat au conseil. L’auto-évaluation individuelle et collective représente une approche plus constructive.
Section 13.6
Développer et maintenir les compétences
Afin de jouer pleinement leur rôle et d’accomplir les devoirs que la loi leur impose, les administrateurs doivent développer et maintenir un haut niveau de compétence.
13.6.1. - Formation continue des administrateurs
La coopérative a l’obligation de donner à ses administrateurs accès à différentes formations adaptées à la charge qu’ils occupent.
La formation des administrateurs doit intervenir à l’arrivée des nouveaux venus, mais aussi de façon continue Nous vous invitons à consulter la section portant sur la formation (section 7.4)
13.6.2. - Soutien aux administrateurs
Il est important que le conseil d’administration soit conscient des limites dans sa capacité à intervenir. Lorsque la coopérative rencontre des difficultés, les administrateurs doivent éviter de confiner la coopérative à une forme d’isolement néfaste. Il n’y a aucune honte à appeler à l’aide. On recourra à un soutien extérieur (ex. : votre fédération) :
- En situation de crise que la coopérative ne peut résoudre par ses seuls moyens;
- Lorsque la situation requiert des expertises qu’elle ne possède pas;
- Pour impartir à des tiers des tâches que les membres ont choisi de ne plus faire eux-mêmes.
13.6.3. - Relève au conseil
La relève au conseil d’administration est importante sur le plan tant de la démocratie coopérative que de la saine gestion de l’entreprise. La difficulté de pourvoir les postes vacants au conseil est généralement signe de lacunes sur le plan de la vie associative. Ultimement, des problèmes de relève au conseil peuvent menacer la continuité de la gestion de l’entreprise, voire sa survie.
Le conseil est responsable d’assurer la continuité de son travail. Pour cela il doit :
- Inciter les membres à présenter leur candidature pour les postes d’administrateurs. Un conseil d’administration réceptif et capable d’effectuer la tâche pour laquelle il a été mandaté incitera les autres membres à vivre cette expérience. Le témoignage des administrateurs en poste constitue bien souvent le meilleur message qui soit pour le recrutement;
- Sensibiliser les administrateurs actuels et les membres au fait qu’il est normal, nécessaire et sain dans une coopérative d’habitation que plusieurs personnes posent leur candidature pour un même poste, même lorsque l’administrateur actuel sollicite un nouveau mandat;
- Accueillir et intégrer les nouveaux administrateurs afin qu’ils aient le sentiment de faire pleinement partie du conseil d’administration;
- Assurer un transfert continu de connaissances des administrateurs expérimentés vers les nouveaux venus.
Section 13.7
Réunions du conseil d'administration
Le conseil d’administration ne peut légalement agir et prendre des décisions que lors de réunions dûment convoquées, pour lesquelles le quorum est constaté et qui sont tenues conformément à la Loi sur les coopératives et au Règlement de régie interne.
Fiche juridique13.7.1. - Fréquence et durée des réunions
Les réunions du conseil d’administration sont plus fréquentes que les assemblées et on y discute souvent des mêmes sujets. Contrairement à l’assemblée des membres qui se penche sur les grandes orientations, le conseil d’administration discute et décide des questions relatives à la gestion de la coopérative.
Il n’existe pas de règle stricte quant à la fréquence des réunions du conseil d’administration. Le conseil doit toutefois se réunir assez souvent pour être en mesure d’assurer un suivi et un contrôle adéquat des affaires de la coopérative. Une pratique courante veut que les membres du conseil d’administration se réunissent environ une fois par mois, avec une pause durant l’été.
Il est important de prévoir et de respecter une durée raisonnable pour les réunions du conseil. La gestion du temps par le président doit donc respecter un équilibre entre la nécessité pour le conseil de prendre le temps nécessaire pour bien faire son travail, tout en évitant les réunions qui s’éternisent. Sauf circonstances exceptionnelles, une durée de deux ou, tout au plus, trois heures représente une norme pouvant servir de guide.
13.7.2. - Convocation
Les réunions sont convoquées par le président ou par deux administrateurs (L.c., art. 92).
Le conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre peut également convoquer une réunion du conseil d’administration. Un représentant de la fédération peut alors assister à cette réunion et y prendre la parole.
Le délai de convocation des réunions est déterminé par le Règlement de régie interne. Sinon, la Loi prévoit un délai de cinq jours avant la date prévue pour la réunion. Rien n’empêche évidemment de convoquer une réunion avant le délai prévu au Règlement ou par la Loi. Ce délai additionnel laissera plus de temps aux administrateurs pour lire la documentation pertinente et bien se préparer.
La Loi permet aux administrateurs de renoncer, par écrit, à l’avis de convocation (L.c., art. 94). La coopérative ne devrait toutefois avoir recours à une telle renonciation que pour des motifs exceptionnels. De même, la seule présence d’un administrateur à une réunion équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation. Dans le cas où l’administrateur participe à la réunion, la renonciation écrite n’est pas requise.Par ailleurs, il est recommandé d’inclure dans le Règlement de régie interne une disposition permettant de réduire le délai de convocation – par exemple à 24 heures – en cas d’urgence.
13.7.3. - Projet d'ordre du jour et documentation
En même temps que l’avis de convocation ou dans un délai raisonnable avant la tenue de la réunion, le secrétaire de la coopérative devrait faire parvenir aux administrateurs un projet d’ordre du jour, ainsi que la documentation pertinente pour la tenue de la réunion.
Les administrateurs ont, pour leur part, le devoir de prendre connaissance, avant la réunion, de l’ensemble des documents qui leur sont transmis Voir la sous-section ''Devoirs des administrateurs ''(Sous-section 13.3.2) .
13.7.4. - Participation aux réunions
À moins d’une disposition à l’effet contraire dans le Règlement de régie interne, les administrateurs peuvent, si une majorité d’entre eux est d’accord, participer à une réunion du conseil par des moyens de communication permettant à tous les participants de communiquer entre eux. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion (L.c., art. 95). Il est cependant essentiel que les membres soient en mesure d’avoir entre eux des échanges en temps réelVoir la sous-section ''Assemblée extraordinaire'' (Sous-section 12.4) .
L’administrateur présent à une réunion du conseil est réputé avoir acquiescé à toute résolution adoptée ou à toute mesure prise alors qu’il est présent à cette réunion, sauf dans les cas suivants (L.c., art. 97) :
- S’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
- S’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
Inversement, un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé n’avoir approuvé aucune résolution ni participé à aucune mesure prise en son absence (L.c., art. 98).
Notons qu’un administrateur ne peut en aucun cas voter par procuration ou se faire représenter à une réunion du conseil.
13.7.5. - Animation des réunions et implication des administrateurs
Bien qu’il existe certaines analogies entre les assemblées de membres et les réunions du conseil quant à la participation et au déroulement, plusieurs différences existent. Ainsi, une réunion du conseil d’administration comporte un nombre plus restreint de personnes. Cela veut dire que les membres peuvent et doivent jouer un rôle beaucoup plus actif. Il est nécessaire que tous les administrateurs s’impliquent. Le manque d’implication de quelques personnes au conseil d’administration est plus lourdement ressenti que celui de quelques membres en assemblée générale.
Un groupe plus restreint permet aussi des règles de procédure moins formelles. Au sein d’un conseil d’administration, il est plus facile de développer un climat de travail et de confiance qui réduit le besoin d’un encadrement important durant les débats.
13.7.6. - Confidentialité des réunions
Les réunions du conseil d’administration se tiennent normalement à huis clos. De plus, les délibérations lors des réunions doivent demeurer confidentielles. Il est essentiel, en effet, que les administrateurs puissent s’exprimer librement lors de ces réunions.
Le conseil peut toutefois permettre la présence d’observateurs, d’employés ou de personnes-ressources (ex. : un membre du personnel de votre fédération). Ces personnes n’ont évidemment pas droit de vote, mais le président peut leur donner un droit de parole. Elles sont également tenues à l’obligation de confidentialité.
13.7.7. - Quorum
La Loi prévoit que le quorum du conseil d’administration est obligatoirement constitué de la majorité des administrateurs (L.c., art. 93) et la coopérative n’a pas le pouvoir de modifier cette règle dans ses règlements.
Le quorum est calculé en fonction du nombre de postes prévus au Règlement de régie interne et non à partir du nombre de postes effectivement pourvus. Par exemple : si votre Règlement prévoit que le conseil d’administration est composé de cinq personnes, trois d’entre elles en constitueront le quorum. Si deux postes au conseil sont vacants, les trois administrateurs en fonction devront toujours être présents aux réunions pour qu’il y ait quorum.
13.7.8. - Les résolutions: moyen d'expression du conseil
Comme c’est le cas pour l’assemblée des membres, le conseil d’administration s’exprime et prend des décisions par l’adoption de résolutions.
Le conseil ne devrait voter sur une résolution que lorsque celle-ci a été formellement proposée et appuyée. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents (L.c., art. 93), sauf dans le cas où la loi prévoit une majorité qualifiée. Ainsi, la décision de suspendre ou d’exclure un membre doit être prise aux deux tiers des voix exprimées par les administrateurs présents (L.c., art. 58).
En cas de partage, le président de la réunion a voix prépondérante (L.c., art. 93). Rappelons que le vote prépondérant n’implique aucunement un second vote du président, mais plutôt qu’en cas d’égalité, le vote de ce dernier emporte la décision.
Résolutions écrites
Lorsqu’une décision doit être prise rapidement et que les circonstances empêchent la tenue d’une réunion en temps utile, il est possible d’adopter une résolution écrite. Celle-ci doit être signée par tous les administrateurs de la coopérative. Afin de simplifier et d’accélérer le processus, la signature du document pourrait se faire par l’utilisation d’une signature numérisée des administrateurs. Il est alors essentiel d’obtenir leur consentement à l’utilisation de telles signatures pour chaque résolution à signer. Un exemplaire de cette résolution est conservé avec les procès-verbaux du conseil (L.c., art. 96).
13.7.9. - Déroulement des réunions
Bien que les réunions du conseil puissent se dérouler avec un peu plus de souplesse et un peu moins de formalisme que les assemblées de membres, elles doivent quand même se dérouler suivant certaines règles de base (ex. : droit de parole, prise des décisions, etc.).
Le président est responsable du bon déroulement des réunions. Avec l’aide du secrétaire, il devra ainsi voir :
- Au respect de l’ordre du jour et de la durée prévue des rencontres;
- À ce que les administrateurs agissent et s’expriment de manière respectueuse envers les autres administrateurs, envers les membres et envers la coopérative;
- À ce que les délibérations et la prise de décision soient conformes aux règles et usages reconnus.
13.7.10. - Après la réunion
Les procès-verbaux représentent en quelque sorte la mémoire des décisions prises par le conseil d’administration. Ils constituent un outil de première importance dans les suivis à faire de ces décisions et dans la reddition de compte du conseil envers les membres dans le cadre du rapport annuel, du rapport d’activité et de l’assemblée annuelle. Il importe donc qu’ils soient rédigés et adoptés avec le plus grand soin.
À partir des notes prises lors de la réunion, le secrétaire de la réunion en rédige le procès-verbalVoir la documentation pour un modèle de canevas pour la prise de note. Les principes et les règles concernant la rédaction du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration sont pour l’essentiel les mêmes que celles qui s’appliquent au procès-verbal d’une assemblée À ce sujet, nous vous invitons à consulter la sous-section ''Après l’assemblée'' (Sous-section 12.3.3) .
Enregistrement des réunions
Aucune règle n’interdit l’enregistrement sonore des réunions du conseil d’administration. Tel enregistrement ne devrait se faire que dans le but de faciliter la rédaction des procès-verbaux et avec le consentement de tous les administrateurs présents. Une fois le procès-verbal rédigé, l’enregistrement devrait être effacé.
L’enregistrement des réunions ne constitue pas une solution miracle pour la rédaction des procès-verbaux. Il peut, en effet, s’avérer long et fastidieux d’écouter plusieurs heures d’une réunion. Une prise de notes adéquate et ne portant que sur les principaux éléments des délibérations et sur les décisions demeure la meilleure façon de préparer la rédaction du procès-verbal.
N’attendez pas à la dernière minute pour rédiger les procès-verbaux. D’une part, plus le souvenir des échanges lors de la réunion est frais à votre esprit, plus il sera facile d’interpréter vos notes. D’autre part, la rédaction diligente des procès-verbaux facilitera la réalisation des suivis des réunions.
Confidentialité
Comme mentionné précédemment, les réunions du conseil d’administration sont tenues à huis clos et le contenu des délibérations doit demeurer confidentiel. Il en est de même des renseignements personnelles ou sensibles qui pourront être portées à la connaissance des administrateurs.
ArticleQuant au procès-verbal, il appartient exclusivement aux administrateurs. En effet, les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration figurent parmi les documents qui doivent, en vertu de l’article 124 de la Loi sur les coopératives, être conservés au registre de la coopérative. Cependant, ils ne sont pas mentionnés à l’article 127 de la Loi, lequel précise les documents que les membres ont le droit de consulter.
Ce qui précède ne signifie pas que les membres doivent être totalement tenus dans l’ignorance de ce qui est discuté lors des réunions du conseil. Au contraire, il est très important que l’ensemble des membres soient informés des décisions prises sur des sujets d’intérêt commun Voir la sous-section ''À la suite des réunions du conseil d’administration'' (Sous-section 7.3.3) .
Suivis des décisions et mandats
Le plus rapidement possible après la réunion, le président de la coopérative, avec le soutien du secrétaire, devrait entreprendre la réalisation des suivis des mandats et des décisions du conseil. La création et la mise à jour après chaque réunion d’un tableau des suivis permettent de consolider et de suivre à la trace tous les mandats que vous confiez à quiconque : qui fait quoi d’ici telle date, à quelle réunion ce mandat a-t-il été confié, etc. Voir la documentation pour un modèle de tableau de suivi au procès-verbal (P.V.) du conseil d'administration (C.A.)
Section 13.8
Première réunion d'un nouveau conseil d'administration
À la suite de l’élection des administrateurs lors de l’assemblée annuelle, le conseil d’administration tient une première réunion. Celle-ci est importante, particulièrement lorsque plusieurs nouveaux administrateurs ont été élus. Au cours de cette réunion, le conseil :
- Nomme des dirigeants;
- Désigne les signataires;
- Mandate le secrétaire pour l’envoi de documents et pour la mise à jour du dossier de la coopérative auprès d’autorités publiques ou coopératives (ex. : direction de l’entrepreneuriat collectif du MEI , fédération, SCHL, SHQ et Registraire des entreprises);
- Mandate le secrétaire de procéder à la mise à jour du plan de classification et du calendrier de conservation et de faire des recommandations au conseil concernant la destruction des documents dont la durée de vie utile est écoulée;
- Transfert, s’il y a lieu, certains dossiers aux nouveaux responsables;
- Demande aux administrateurs de signer des engagements touchant la confidentialité et les conflits d’intérêts.
Cette première réunion représente une occasion intéressante de présenter brièvement le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et dirigeants. Cela constitue un rappel utile pour les administrateurs plus expérimentés et un avant-goût d’une formation à venir sur les devoirs des administrateurs pour les nouveaux venus.
13.8.1. - Nomination des dirigeants
Le conseil nomme les dirigeants de la coopérative, soit un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Le nouveau conseil répartit les postes en fonction des intérêts et des capacités de chacun. Par exemple, le secrétaire doit être capable de prendre des notes et de rédiger des procès-verbaux. Il doit de plus être une personne ordonnée, responsable et capable de respecter les échéances fixées.
Si plus d’une personne est intéressée par un poste et capable de l’occuper, le conseil procède au vote pour l’attribution du poste. La répartition des postes est notée au procès-verbal et communiquée aux membres dès que possible.
Pour en savoir plus concernant les dirigeants et leur rôle, nous vous invitons à consulter le chapitre 14.
13.8.2. - Désignation des signataires
Le conseil nomme en début de mandat trois de ses membres pour signer, au nom de la coopérative, les documents bancaires (chèques, dépôts à terme, transferts de comptes, etc.), les contrats (ex. : réparations, contrat de membre, baux, etc.), les conventions d’exploitation avec les organismes gouvernementaux (SCHL et SHQ), etc. Habituellement, les signataires sont le président, le secrétaire et le trésorier. Lorsque la coopérative a engagé une direction générale, celle-ci sera normalement aussi désignée comme signataireVoir la documentation pour un modèle de résolution de désignation des signataires.
Comme les institutions financières peuvent avoir des exigences particulières quant aux documents à remplir ou à fournir pour autoriser de nouveaux signataires, il est prudent de se procurer leurs formulaires et de prendre connaissance de leurs exigences afin de s’assurer que les résolutions formulées par le conseil seront acceptées. Les résolutions sont notées au procès-verbal de la réunion.
13.8.3. - Préparation et envoi de documents à des tiers
Rappelons qu’à la suite de la tenue de l’assemblée annuelle, le conseil d’administration de la coopérative doit préparer et transmettre certains documents et informations à différents organismes, notamment :
- Direction de l’entrepreneuriat collectif du MEI : rapport annuel incluant les états financiers audités et signés et formulaire Renseignements supplémentaires obligatoires;
- Fédération dont la coopérative est membre : rapport annuel incluant les états financiers audités et signés;
- Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec : déclaration de revenus (incluant les états financiers audités et signés);
- SCHL ou SHQ : états financiers audités et signés et tous autres documents exigés en vertu de la convention d’exploitation;
- Registraire des entreprises : s’il y a lieu, pour la mise à jour des informations concernant la coopérative (ex. : administrateurs, dirigeants, adresse) auprès du registraire des entreprises.
Pour en savoir plus, consulter le chapitre 12.
13.8.4. - Transfert des dossiers
Il est très important d’effectuer un bon transfert des dossiers en cours. Les administrateurs sortants ont beaucoup d’informations. Les connaissances acquises et l’expertise développée en cours de mandat sont précieuses. Elles doivent être transférées aux nouveaux administrateurs.
Trousse pour les nouveaux administrateurs
Chaque nouvel administrateur devrait recevoir – en format cartable ou numérique – une trousse incluant, par exemple, les documents ou informations suivantes :
- Règlements et politiques de la coopérative;
- Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et dirigeants;
- Procès-verbaux des réunions du conseil de l’année précédente;
- Document résumant les devoirs des administrateurs et les attentes de la coopérative à leur égard;
- Résumé des règles et procédures en usage au conseil (ex. : droits de parole, processus de délibération et de vote, etc.);
- Informations générales concernant la coopérative (ex. : historique, mission, valeurs, code de vie, liste des immeubles, nombre de logements, etc.) et sur le Mouvement (ex. : votre fédération et la CQCH);
- Liste des noms et coordonnées (téléphone et adresse électronique) des administrateurs.
La façon la plus simple de procéder consiste à prévoir une rencontre entre les administrateurs sortants et les nouveaux venus. Cette rencontre, si possible, devrait constituer la deuxième partie de la première réunion du nouveau conseil d’administration (la première partie étant le règlement des questions d’ordre technique).
Certaines coopératives procèdent par poste : rencontre entre l’ancien trésorier et le nouveau, etc. Cette façon de faire, quoique valable et très efficace pour des responsabilités spécifiques, ne donne pas la possibilité au nouveau conseil d’avoir une vue d’ensemble des affaires et des enjeux au sein de la coopérative.
Passez en revue les éléments suivants :
- L’information reçue sur les dossiers traités par l’ancien conseil, mais non fermés;
- Les résolutions adoptées par l’assemblée;
- Le calendrier de gestion;
- La convention et les contrats en cours;
- Les bilans et plans d’action des comités et du conseil d’administration.
Un échange d’information devrait avoir lieu concernant le fonctionnement des comités, sur la gestion en général et les possibilités d’amélioration.
Organisation du travail
La coopérative ne doit pas repartir à zéro chaque année. Il y a des pratiques et des méthodes déjà établies. On ne doit pas tout bousculer sous prétexte qu’on a un nouveau conseil d’administration. Il y a sûrement des choses à changer, mais le changement doit se faire en douceur et permettre une amélioration.
Enfin, assurez-vous, s’il y a lieu, de récupérer tous les documents et outils de travail (ex. : guide en format cartable, ordinateur appartenant à la coopérative, clé USB, codes et mots de passe permettant l’accès aux différents dossiers en ligne de la coopérative [ex. : institutions financières, Registraire des entreprises, Hydro-Québec, assureur, etc.]) encore détenus par les administrateurs sortants.
POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS …
Langlois – avocats, Au-delà des devoirs de diligence et de loyauté… la responsabilité civile des administrateurs.
Site Internet du MEI : Administrer une coopérative : défis, obligations et responsabilités.